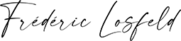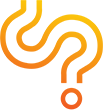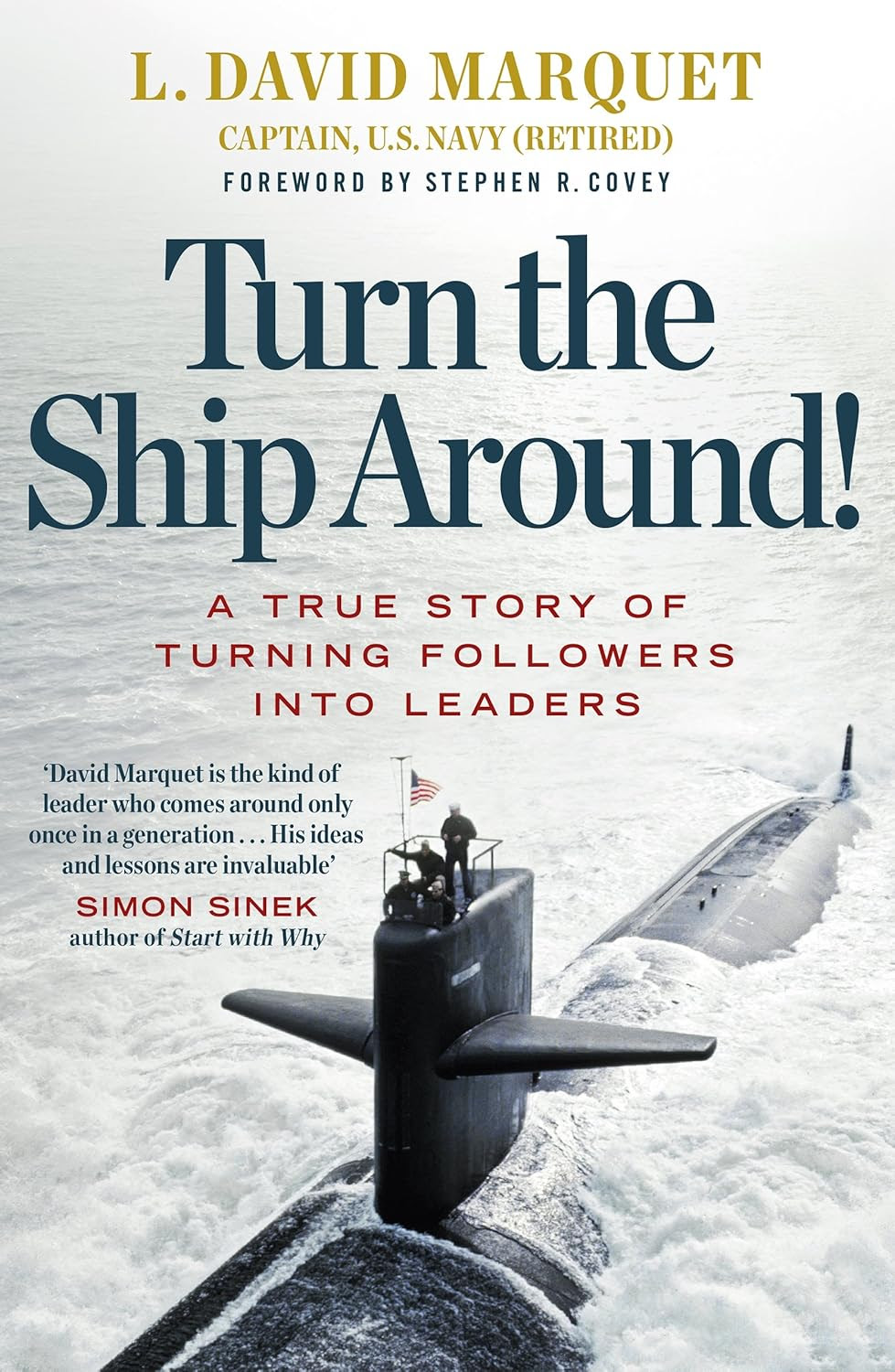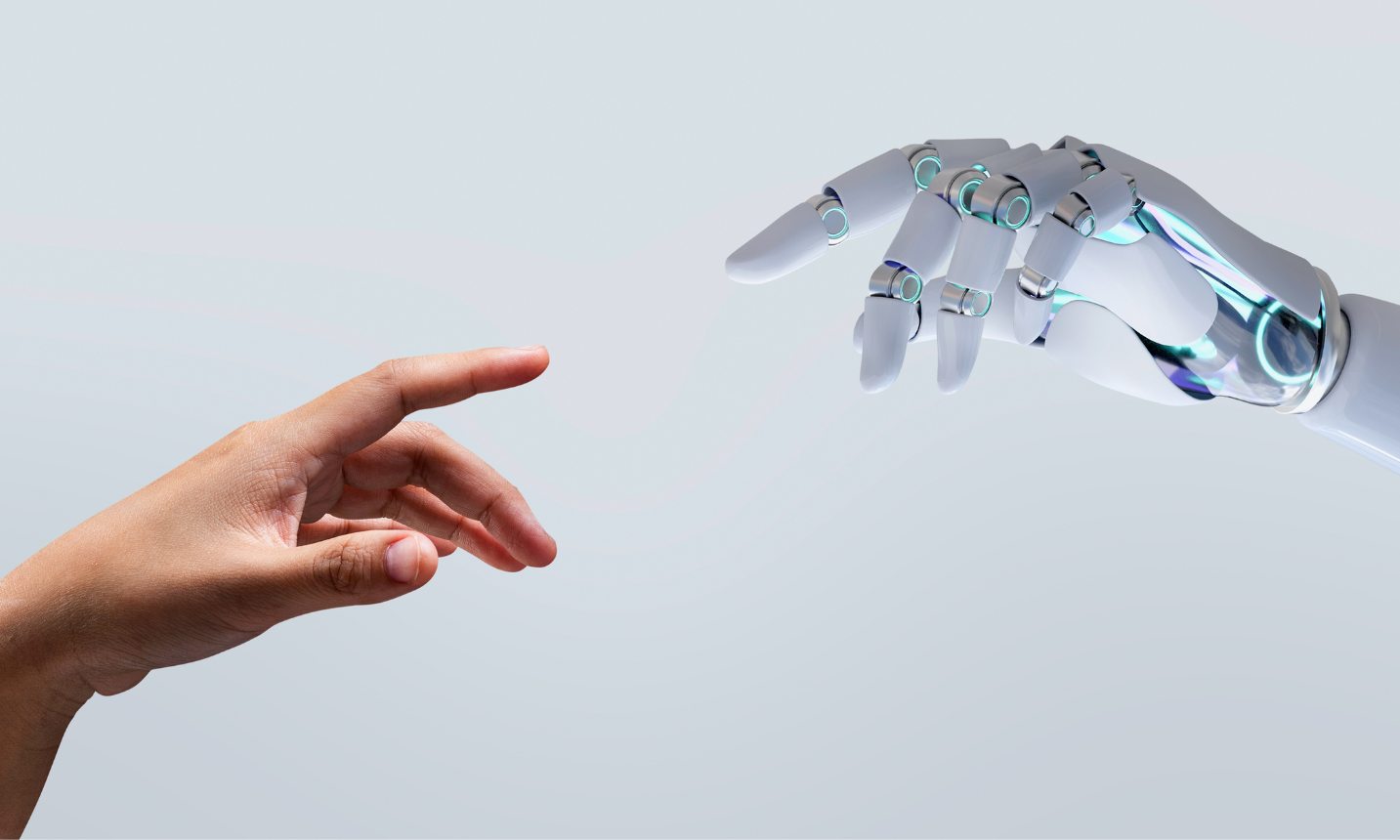
Réenchanter le travail : du geste à l’ère du numérique
L’humain face à la machine
Depuis la révolution industrielle, chaque progrès technologique a bousculé notre manière de travailler. Mais jamais le fossé entre l’humain et la machine n’a semblé aussi vertigineux qu’aujourd’hui.
Entre les IA génératives, les visio à rallonge, les process numériques omniprésents, beaucoup ont le sentiment que le travail s’est dématérialisé jusqu’à en perdre son corps.
Pourtant, une autre voie s’ouvre : celle d’un numérique réhumanisé, où la technologie devient un levier d’épanouissement plutôt qu’un outil de contrôle.
Et, paradoxalement, c’est peut-être en redonnant toute sa valeur au geste, à ce qui relie le savoir, le faire et le sens, que nous pourrons réellement réenchanter le travail.
1. L’usure numérique : quand l’outil épuise
Le syndrome du “visio-burnout”
Les études se multiplient sur les effets du travail à distance intensif. Les chercheurs parlent aujourd’hui de syndrome de visio-burnout : surcharge cognitive, épuisement attentionnel, stress lié à la sur-connexion.
Les visios successives maintiennent le cerveau dans une posture de vigilance permanente. L’image de soi renvoyée à l’écran agit comme un miroir continu qui empêche le relâchement.
À cela s’ajoute la peur diffuse que suscitent les IA : selon une enquête 2024, 79 % des Français se disent inquiets vis-à-vis des intelligences artificielles, contre 68 % l’année précédente.
Cette inquiétude est légitime. Derrière la promesse d’efficacité se cache une crainte de dévalorisation : peur d’être remplacé, de perdre la main, de ne plus maîtriser la finalité de son travail.
2. L’épanouissement digital : un horizon encore inexploré
La Fabrique Spinoza parle d’épanouissement digital pour désigner une approche plus vertueuse du numérique.
Plutôt que d’opposer technologie et humanité, il s’agit de penser comment les outils peuvent renforcer l’autonomie, la coopération et la créativité.
Quelques bonnes pratiques
- Réguler les temps de visio : éteindre la caméra régulièrement pour réduire la charge mentale.
- Programmer les réunions 5 minutes plus courtes que prévu, pour laisser place à la respiration.
- Intégrer des moments de déconnexion réelle, sans notification ni écran.
Ces micro-ajustements, bien qu’anecdotiques en apparence, traduisent une philosophie : reprendre la main sur la technologie au lieu de la subir.
Des outils qui recréent du lien
De nouvelles plateformes comme GatherTown ou Teemyco réinventent la visioconférence.
Leur principe : simuler un univers de bureau en 2D où les avatars se déplacent librement, et où la conversation démarre spontanément dès qu’on s’approche d’un collègue virtuel.
Cette “sérendipité digitale” redonne au travail à distance ce qui lui manque souvent : la spontanéité et la convivialité.
Le numérique, bien pensé, peut donc favoriser les rencontres, au lieu de les étouffer.
3. L’intention derrière la technologie
La question n’est pas tant “faut-il ou non utiliser l’IA ?” que : dans quelle intention le faisons-nous ?
L’IA n’est ni bonne ni mauvaise ; elle reflète la culture de l’organisation qui l’adopte.
Le Département du Morbihan, par exemple, a lancé un groupe de réflexion sur l’impact de l’IA sur les métiers pour s’assurer de son usage vertueux.
Chez CNP Assurances, un accompagnement externe aide les collaborateurs à comprendre l’IA plutôt qu’à la craindre.
Ces initiatives rappellent une évidence : la technologie ne doit pas appauvrir les compétences humaines, mais les augmenter.
Son objectif n’est pas de remplacer la main de l’homme, mais de la rendre plus libre.
4. Le geste : retrouver la main, retrouver le sens
Ayant dirigé la production des Cristalleries de Saint-Louis, je garde en mémoire cette fascination pour le geste juste : celui du souffleur qui, d’un mouvement précis, donne forme au verre encore incandescent.
Le geste, c’est la rencontre du savoir et du corps. C’est un langage muet, une mémoire vivante.
Le geste managérial
Transposé au management, le geste garde tout son sens.
On parle beaucoup d’outils : feedback, entretiens, plans d’action. Mais que valent ces outils sans le bon geste ?
Le geste managérial, c’est la posture, le ton, l’attention portée à l’autre. Ce qui transforme un acte mécanique en acte juste.
Apprendre le bon geste prend du temps. Comme l’artisan, le manager progresse par répétition, observation, ajustement. C’est un apprentissage lent, mais profondément humain.
Le geste comme lien invisible
Dans une équipe soudée, le geste devient un langage partagé.
Aux Cristalleries, un simple regard suffisait à coordonner toute une chaîne de production : le cueilleur apporte le cristal, le souffleur indique d’un mouvement du pied quand fermer le moule, le gamin comprend sans un mot.
Cette intelligence collective incarnée illustre ce que nous perdons quand le travail se réduit à des écrans et des process : la présence, la confiance, la beauté du mouvement coordonné.
5. Le travail bien fait : une aspiration fondamentale
Le sociologue Gollac et le psychiatre Déjours l’ont montré : ne pas pouvoir “bien faire son travail” est une source majeure de souffrance.
Le travail empêché — ce sentiment de devoir bâcler, d’être empêché par les procédures — est l’une des causes principales des risques psychosociaux.
À l’inverse, la possibilité de bien faire, de maîtriser son art, agit comme une source de fierté et d’équilibre psychologique.
Le geste comme moteur de motivation
Pour Bandura, la motivation intrinsèque naît du plaisir même de l’acte.
Quand la motivation vient de la qualité du geste, elle dépasse les récompenses externes.
C’est ce qu’on appelle le flow : cet état de concentration intense où l’on oublie le temps, où l’on est “dans” ce qu’on fait.
Cet état vertueux allie performance et bien-être. Il apparaît quand les conditions sont réunies :
- un but clair et choisi,
- un niveau de défi adapté,
- et la possibilité d’agir sans interruption.
6. Le retour des métiers : redonner corps à l’entreprise
La redécouverte du geste s’accompagne d’un renouveau des métiers.
L’INSEE notait déjà qu’en 2019, près de 10 % des créations d’entreprises artisanales provenaient d’anciens cadres.
Menuiserie, céramique, ferronnerie, bijouterie : ces métiers manuels redeviennent des refuges de sens pour ceux qui fuient l’abstraction.
Mais cette tendance ne se limite pas à l’artisanat.
Les grandes entreprises s’en inspirent : dans le luxe, chaque artisan signe la pièce qu’il a réalisée.
Chez Favi, entreprise industrielle pionnière, les ouvriers redessinent eux-mêmes leurs mini-usines : 80 % des innovations naissent à trois niveaux hiérarchiques sous la direction.
Ces exemples prouvent qu’en plaçant le producteur au centre, on réactive la créativité, la fierté et la performance.
7. Quand la technologie sert le geste
Loin d’être antagonistes, le geste et la technologie peuvent se renforcer mutuellement.
L’impression 3D, la réalité augmentée, les outils collaboratifs permettent aujourd’hui de retransmettre des savoir-faire, de documenter les gestes rares, de former autrement.
Des initiatives comme Le Cercle de Pierres invitent les cadres à expérimenter le travail manuel — tailler la pierre pour comprendre la matière, la patience et la transformation.
“Ce que tu fais, te fait”, résume Marc Puche, son fondateur. Cette phrase contient à elle seule tout l’enjeu du réenchantement : comprendre que le travail, quand il est vécu pleinement, façonne autant l’objet que l’individu.
8. Vers une nouvelle organisation des savoir-faire
Certaines entreprises explorent déjà des modèles qui reconnectent les métiers entre eux.
En Occitanie, la Fabrique des AS réunit assistants et secrétaires pour réinventer leurs pratiques par le collectif.
Au CEA, la “filière expertise” est reconnue au même niveau que le parcours managérial : une manière de valoriser les métiers eux-mêmes, pas seulement les fonctions de direction.
On voit se dessiner une organisation plus horizontale, fondée sur des corporations apprenantes, où chaque métier trouve sa place dans une œuvre commune.
9. Réenchanter le travail : réconcilier la main et la tête
Le numérique a libéré, mais il a aussi désincarné.
Le geste, lui, réincarne, mais il a besoin d’un environnement moderne pour se déployer.
Réenchanter le travail, c’est articuler les deux :
- la main, pour l’ancrage, le savoir-faire, la maîtrise ;
- la tête, pour la créativité, la réflexion, la vision ;
- et le cœur, pour relier les deux.
Ce triptyque — main, tête, cœur — est la base d’un travail vivant.
Un travail qui ne s’oppose pas à la technologie, mais qui l’oriente vers plus d’humanité.
10. Un nouvel art du management
Dans cette perspective, le rôle du manager change profondément.
Il n’est plus celui qui contrôle, mais celui qui oriente les gestes et cultive les conditions du flow.
Son pouvoir ne vient pas de la hiérarchie, mais de sa capacité à maintenir le lien entre sens, compétence et confiance.
Le geste managérial devient alors un art : celui de créer des environnements où les collaborateurs peuvent bien faire leur travail, apprendre, se tromper et recommencer.
Remettre la main sur le travail
Le progrès technique n’a de valeur que s’il renforce la dignité du geste humain.
L’enjeu n’est pas de choisir entre IA et artisanat, mais de réconcilier les deux.
Quand la technologie libère du temps, qu’elle facilite la coopération et qu’elle redonne le pouvoir d’agir, elle devient une alliée du réenchantement.
Mais quand elle contrôle, mesure, épuise, elle sape ce lien invisible entre l’humain et ce qu’il crée.
Réenchanter le travail à l’ère du numérique, c’est finalement remettre la main sur le travail :
la main qui fabrique, qui relie, qui invente.
Celle qui donne forme, sens et beauté à nos organisations.
Chez F Cube, nous aidons les entreprises à repenser leurs modes de travail pour redonner de la fluidité, du sens et du plaisir d’agir.
Parce que, numérique ou pas, le travail reste une affaire de gestes, de regards et d’humains.
Alors, intéressés ? Si oui, cliquez contactez-moi ici.