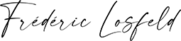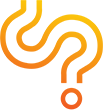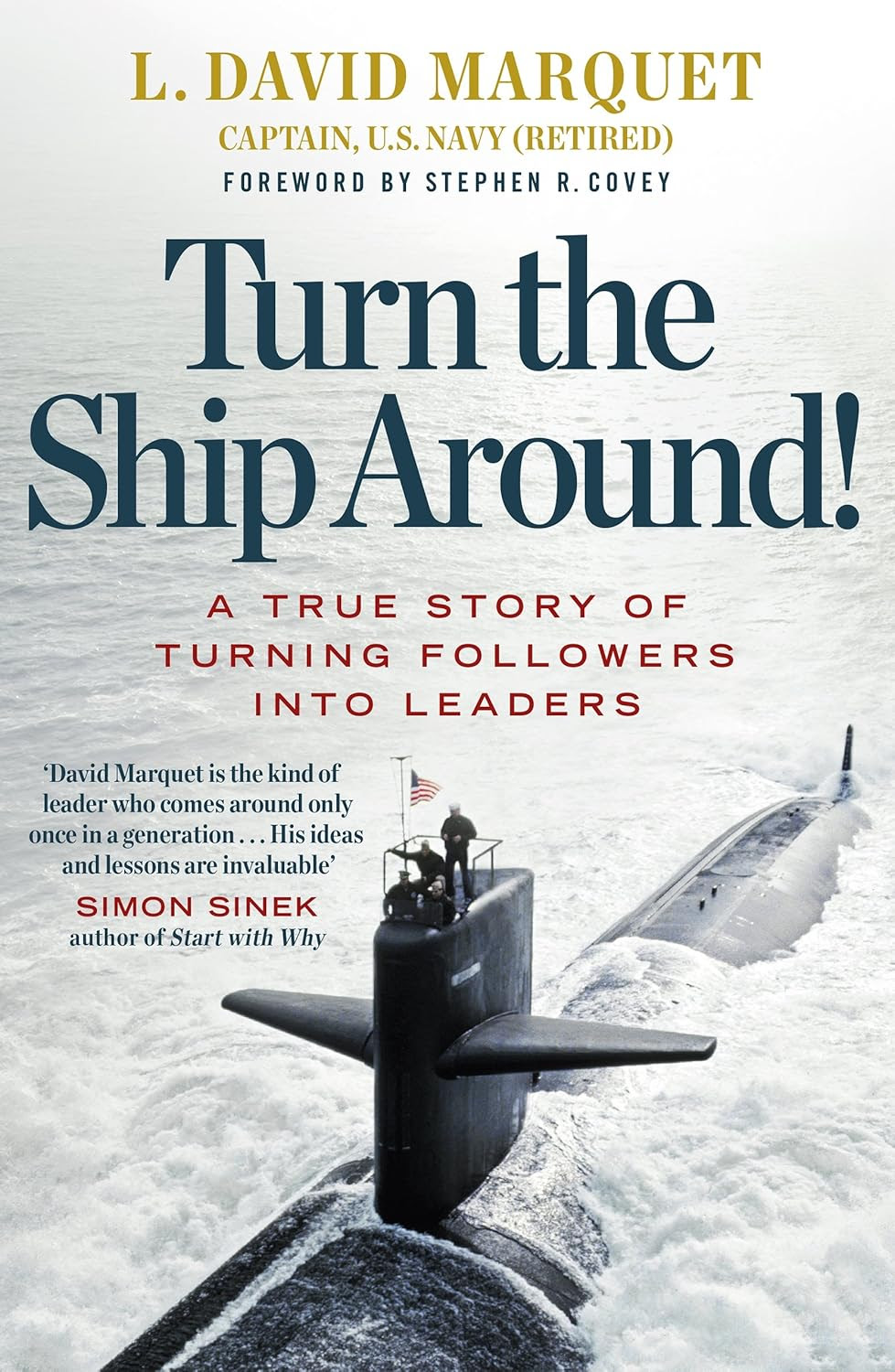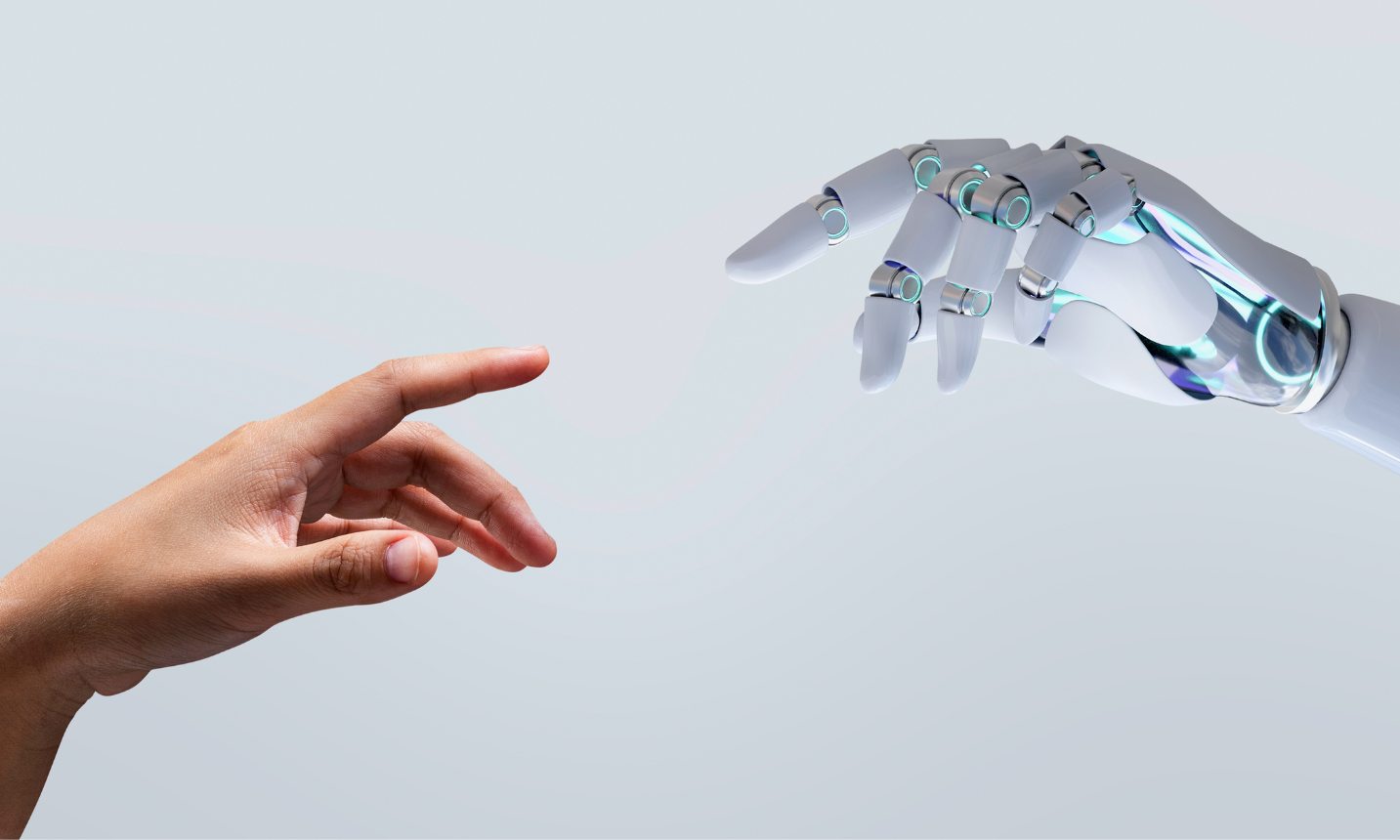Réenchanter le travail : du sens individuel à la transformation collective
Le mot “sens” fait aujourd’hui partie du vocabulaire courant du management. On le retrouve dans les conférences RH, sur les affiches de recrutement et jusque dans les conversations du lundi matin. Et pourtant, derrière ce mot tant répété, une fatigue s’installe. Le “sens” semble vidé de sa substance, transformé en slogan plus qu’en réalité vécue.
Pourtant, la Fabrique Spinoza, dans une étude aussi dense que précieuse sur l’évolution du travail depuis la crise sanitaire, nous invite à revisiter cette notion avec nuance. Le sens au travail n’est ni une mode ni une injonction morale : il constitue une clé de compréhension majeure des mutations actuelles du monde professionnel.
Depuis la crise du Covid, quelque chose s’est fissuré : notre rapport au travail. Le “divorce” entre travail et vie — que nous évoquions dans cet article (lien) — a ouvert la voie à une quête nouvelle : celle de réenchanter le travail. Non pas par naïveté, mais parce que l’enchantement, au sens profond du terme, c’est retrouver la vibration, la cohérence, la direction.
Qu’entend-on par “sens au travail” ?
Le mot “sens” vient du latin sensus, qui signifie à la fois “direction”, “signification” et “perception”.
Appliqué au travail, il recouvre ces trois dimensions :
- La direction : pourquoi je fais ce que je fais, à quoi cela contribue.
- La signification : ce que je comprends du rôle que je joue dans un ensemble plus grand.
- La sensation : ce que je ressens en exerçant mon métier, l’expérience vécue au quotidien.
Trouver du sens, c’est donc aligner ces trois niveaux : savoir où l’on va, pourquoi on y va et ce que l’on éprouve en chemin.
C’est ce qui explique qu’on puisse avoir un emploi “utile” sans y trouver de sens, ou au contraire, se sentir profondément aligné dans une mission modeste.
Le sens n’est pas donné par l’entreprise : il se co-construit, entre l’organisation, le collectif et la personne.
1. Le sens au travail : entre désillusion et nécessité
Longtemps, le travail a été perçu comme une valeur refuge. Dans les années 1990, 60 % des Français déclaraient que le travail occupait une place très importante dans leur vie. En 2023, ils ne sont plus que 25 % à le penser (source : IFOP / Fondation Jean Jaurès).
Ce chiffre ne traduit pas un désintérêt pour le travail, mais un changement de nature du lien au travail.
Le sens, un besoin universel
Le sens n’est pas une préoccupation “de cadres” ou de “bobos en reconversion”. Il touche toutes les catégories sociales, même si ses expressions diffèrent.
Les travaux de la Dares (Coutrot & Perez) montrent que le sens du travail est corrélé négativement avec le niveau de diplôme, mais que sa perte augmente le risque dépressif de la même manière pour tous.
Autrement dit : un ouvrier et un cadre peuvent souffrir de ne plus trouver de sens, simplement à des niveaux et pour des raisons différentes.
Le sens est donc un besoin psychologique fondamental, et non un luxe. Il agit comme un bouclier contre les conditions difficiles, comme un repère dans les périodes de doute, et comme un lien social dans un monde du travail de plus en plus fragmenté.
Une quête récente mais profonde
La question du sens au travail n’a réellement émergé que dans les années 2000. Depuis, l’intérêt n’a cessé de croître : on compte six fois plus de recherches Google sur le sujet en 2025 qu’en 2011.
L’étude Audencia / Jobs That Make Sense (2022) va même plus loin : 92 % des actifs s’interrogent sur le sens de leur activité.
Ce n’est plus une minorité en quête spirituelle : c’est une majorité lucide.
2. Quand le non-sens rend malade
Le sens au travail n’est pas qu’une question existentielle. Il a des conséquences directes sur la santé mentale, la motivation et la performance.
Entre 2013 et 2016, pour les 20 % des salariés dont le sens du travail a le plus diminué, l’absentéisme a augmenté de 40 % (Coutrot & Perez).
Inversement, quand le sens augmente, l’absentéisme baisse de 18 %.
Le non-sens comme facteur de risque
Selon le sociologue Gollac, ne pas pouvoir “bien faire son travail” est l’une des six causes principales de risques psychosociaux. Cette impossibilité crée un travail empêché : le sentiment d’être en contradiction avec sa mission, ses valeurs, ou même ses compétences.
Les salariés s’épuisent non pas à cause du volume de travail, mais parce qu’ils ne reconnaissent plus la finalité de ce qu’ils font.
Le sens, rempart face à la souffrance
À l’inverse, un travail signifiant agit comme un facteur protecteur.
Les recherches de Bernaud (2016) montrent que le sens permet de “tenir” malgré des conditions difficiles, en maintenant une cohérence intérieure.
Et certaines études vont encore plus loin : selon Julianne Holt-Lunstad et son équipe, exercer un métier perçu comme utile pourrait prolonger l’espérance de vie de 50 %.
Autrement dit : le sens au travail, c’est aussi une question de santé publique.
3. De la quête individuelle au collectif éclaté
Ce qui change aujourd’hui, c’est que la quête de sens s’est individualisée. Là où, autrefois, elle était portée par des collectifs (syndicats, métiers, communautés professionnelles), elle est devenue une responsabilité personnelle.
Chacun cherche “son” sens, parfois dans la solitude.
Cette individualisation crée un paradoxe : elle donne de la liberté, mais fragilise le lien collectif.
Le travail devient une affaire de “projet personnel”, et non plus une aventure partagée. Or, un travail sans collectif, c’est un travail sans épaisseur.
4. Des entreprises qui deviennent des archipels
La Fabrique Spinoza décrit une évolution fascinante : l’entreprise se désagrège sous sa forme classique, pour se recomposer en archipel.
C’est-à-dire un ensemble d’îlots reliés par une vision commune, mais autonomes dans leur fonctionnement.
L’entreprise archipel : une mutation silencieuse
Cette transformation se voit sur plusieurs plans :
- les lieux : le travail se décentralise, entre bureaux satellites, coworkings, télétravail ;
- les temps : les horaires se désynchronisent, chacun composant avec son rythme ;
- les statuts : la frontière entre salariés, freelances et partenaires devient floue ;
- la nature du travail : il ne se définit plus par un lieu ni par un horaire, mais par une mission.
L’étude Forbes (2024) révèle que 45 % des jeunes préfèrent travailler à leur compte plutôt que de signer un CDI.
Le nombre d’indépendants a doublé en dix ans, et près de 30 % des salariés envisagent d’exercer leur métier actuel en freelance.
L’entreprise augmentée
Pour Catherine Barba, “la dichotomie dedans / dehors a de moins en moins de sens”.
Les entreprises doivent donc apprendre à manager des écosystèmes, pas seulement des collaborateurs.
C’est ce qu’elle appelle “l’entreprise augmentée” : une organisation qui inclut les indépendants, partenaires et acteurs du territoire dans sa dynamique.
Des exemples inspirants
- BlaBlaCar a repensé ses implantations autour d’un modèle “Club & Hub” : un lieu central d’appartenance, complété par des satellites locaux ouverts dès qu’un seuil d’effectif est atteint.
- La RATP construit des logements à proximité des postes de travail pour renforcer l’ancrage territorial.
- Wave of Change crée des alliances locales en connectant entreprises et acteurs du territoire autour d’une vision commune.
Ces initiatives illustrent un même mouvement : le travail se territorialise.
L’entreprise ne disparaît pas : elle change d’échelle et de nature.
5. Recollectiviser le sens : un défi managérial
La question du sens, devenue individuelle, doit redevenir collective pour réenchanter le travail.
Cela passe par une redéfinition du rôle de l’entreprise : non plus seulement produire ou performer, mais tisser du lien, à l’intérieur et autour d’elle.
Trois leviers pour agir
- Relier les métiers : remettre au centre les savoir-faire et les communautés professionnelles, souvent invisibles dans les organisations.
- Créer des espaces de dialogue : où les collaborateurs peuvent parler de ce qu’ils font, de ce qui a du sens ou non dans leur quotidien.
- Ancrer l’entreprise dans son territoire : en favorisant les collaborations locales, les initiatives d’intérêt collectif, les alliances ouvertes.
Ces leviers, loin d’être idéalistes, renforcent à la fois l’engagement, la cohésion et l’innovation.
Le sens comme stratégie
Le sens n’est pas un supplément d’âme. C’est une stratégie de survie organisationnelle.
Une entreprise qui ne donne plus de sens finit par le subir : désengagement, fuite des talents, perte de performance.
À l’inverse, celles qui investissent ce terrain gagnent en clarté, en attractivité et en résilience.
6. Et si le sens devenait la nouvelle performance ?
Les années à venir verront sans doute émerger une nouvelle forme de compétitivité : celle du sens.
Non pas un sens plaqué dans des chartes RSE, mais un sens vécu : incarné dans la manière de travailler, de manager, de collaborer.
Le sens ne s’enseigne pas, il se construit.
Et cette construction passe par des organisations capables d’écouter leurs collaborateurs, d’accepter la complexité, et de donner à chacun la possibilité d’agir sur son environnement.
Réenchanter le travail, ce n’est donc pas rêver d’un monde parfait.
C’est accepter que le travail redevienne un espace vivant, humain, multiple, où l’individu et le collectif trouvent enfin un terrain d’entente.
Chez F Cube, nous accompagnons les organisations qui souhaitent recréer du lien, redonner du sens et retrouver une dynamique collective durable.
Parce que réenchanter le travail, ce n’est pas une utopie.
C’est un choix stratégique, profondément humain.
Alors, intéressés ? Si oui, contactez-moi ici.