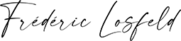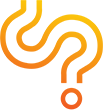Travail et vie : le divorce s’installe quand l’autonomie disparaît
Avant 2020, la question du sens et de l’équilibre au travail était déjà présente, mais elle restait secondaire pour beaucoup d’entreprises. La crise sanitaire a tout changé : en quelques semaines, le télétravail est devenu la norme pour des millions de personnes, les circuits décisionnels ont été raccourcis, et les équipes ont appris à fonctionner avec une simplicité inédite.
Cinq ans plus tard, le constat est amer : beaucoup d’organisations ont voulu reprendre « comme avant », en réinstaurant des règles strictes et un contrôle renforcé. Ce retour en arrière est vécu comme une véritable régression par les salariés, au point que le sociologue François Dupuy parle d’un « divorce entre le travail et la vie ».
1. Un désengagement qui ne cesse de croître
Des chiffres qui parlent
- Selon le rapport annuel de Gallup “State of the Global Workplace 2025” le taux d’engagement des salariés dans le monde a chuté à 21 %, contre 23 % l’année précédente.
- L’absentéisme. En 2024, 42 % des salariés s’est vu prescrire au moins un arrête maladie. (source : Malakoff Humanis).
- Le turnover moyen en France atteint les 16 % en 2024.
Ces chiffres traduisent un malaise profond : le problème n’est pas que les salariés ne veulent plus travailler, mais qu’ils refusent un cadre qu’ils jugent étouffant.
Le malentendu des « jeunes générations »
On entend souvent que la génération Z ne veut plus travailler. Or, les études disent l’inverse : elle veut travailler, mais dans un cadre plus flexible, plus transparent, et surtout plus respectueux de la vie personnelle.
2. Autonomie : du besoin à la nécessité
Ce que les salariés ont découvert pendant le Covid
Le confinement a été un laboratoire grandeur nature. Sans bureaucratie omniprésente, beaucoup ont découvert :
- une efficacité accrue (décisions plus rapides, réunions réduites,…) ;
- une souplesse organisationnelle (adapter ses horaires, gérer son temps) ;
- un meilleur équilibre vie pro/vie perso.
Résultat : les salariés ne veulent plus revenir en arrière. Pour eux, l’autonomie est devenue non négociable.
Pourquoi l’autonomie est si importante
L’autonomie n’est pas qu’un confort : c’est un levier direct de performance.
- Des chercheurs en psychologie du travail (Deci & Ryan, théorie de l’autodétermination) montrent que l’autonomie est un besoin psychologique fondamental.
- Plus d’autonomie = plus de motivation intrinsèque = plus d’innovation.
- A contrario, un contrôle excessif génère stress, burn-out et désengagement.
3. Le retour du contrôle : un mauvais réflexe
Bureaucratie 2.0
Face au désengagement, beaucoup d’entreprises ont réagi par un réflexe classique : remettre de l’ordre.
Mais en cherchant à « reprendre la main », elles ont souvent ralenti, alourdi, et démotivé.
Le flex-office imposé, le reporting permanent, les outils de suivi du télétravail sont autant de signaux d’un retour en force du contrôle.
Ce que ces dispositifs traduisent, ce n’est pas un besoin de performance, mais une perte de confiance.
Or, c’est justement cette confiance — éprouvée pendant le Covid — qui avait permis aux équipes d’être plus autonomes, plus réactives et plus efficaces.
Résultat : les salariés ont l’impression qu’on leur retire ce qu’ils avaient gagné, qu’on les infantilise à nouveau. Et ce ressenti alimente directement le désengagement.
Le paradoxe du management moderne
C’est là que le malentendu s’installe.
Depuis dix ans, les entreprises communiquent sur l’« agilité », la « coopération », la « responsabilisation ». Mais derrière les slogans, la réalité reste souvent celle d’un management sous contrôle.
Les managers intermédiaires sont les premiers piégés : on leur demande à la fois d’encourager la prise d’initiative et de justifier chaque action dans des tableaux de bord.
Ce double discours crée une tension permanente :
- des réunions où tout le monde parle d’autonomie, mais où rien ne peut être décidé sans validation,
- des injonctions paradoxales (« soyez créatifs, mais respectez la procédure »),
- un sentiment diffus d’être observé plutôt qu’écouté.
Ce décalage entre le discours et la pratique alimente directement le malaise. Le contrôle s’est déplacé, il s’est digitalisé, mais il n’a pas disparu. Et c’est cette incohérence qui accélère le divorce entre le travail et la vie.
4. Les conséquences du « divorce » entre le travail et la vie
Désengagement silencieux (« quiet quitting »)
Plutôt que de démissionner, beaucoup de salariés réduisent leurs efforts au strict minimum. Ils font ce qui est demandé, sans plus.
Fuite des talents
Les plus compétents partent pour des structures offrant davantage de liberté, notamment les PME, les startups ou deviennent freelance.
Souffrance psychologique
Un contrôle excessif réduit l’autonomie perçue, ce qui entraîne une hausse des risques psychosociaux : stress, anxiété, burn-out.
5. Que peuvent faire les dirigeants ?
Alléger la bureaucratie
- Supprimer les processus inutiles (reportings qui ne servent pas, validations multiples).
- Favoriser les outils simples et compréhensibles.
Redonner des marges de manœuvre
- Fixer des objectifs clairs, mais laisser la méthode aux équipes.
- Encourager les expérimentations locales.
Développer une culture de la confiance
- Former les managers à un leadership basé sur la responsabilisation et non sur le contrôle.
- Valoriser la prise d’initiative plutôt que la conformité.
Reconnaître les besoins des salariés
- Plus de transparence sur les décisions.
- Un vrai dialogue social, pas seulement descendant.
Un choix stratégique pour l’avenir
Le « divorce » entre le travail et la vie n’est pas une fatalité. Mais il impose aux entreprises un changement de posture : passer d’une logique de contrôle à une logique de confiance.
Les salariés ont montré qu’ils pouvaient être performants en autonomie. Les organisations qui sauront le reconnaître attireront et fidéliseront les talents. Les autres risquent de voir le fossé se creuser.
La vraie question est simple : préfère-t-on des salariés contrôlés ou des collaborateurs engagés ?